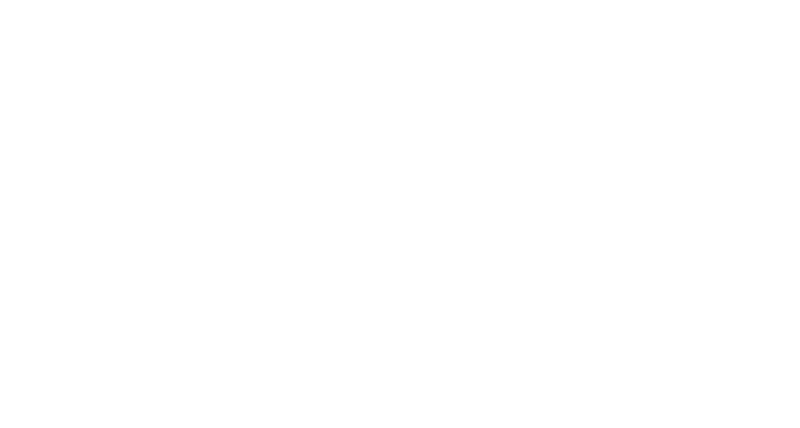En septembre, l’Europe célèbre le patrimoine lors de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine.
Cette année, le patrimoine architectural est à l’honneur ! “Des monuments emblématiques aux constructions vernaculaires, des décors intérieurs aux objets mobiliers”, il se révèle dans toute sa diversité. Témoignage de notre histoire, il est à la fois outil de mémoire collective et reflet de notre culture.
Rappelons que la notion même de « patrimoine architectural » poursuit son évolution dans la première moitié du XXe siècle, en s’élargissant au « patrimoine urbain ». D’après l’historienne Françoise Choay (1925 – 2025), l’expression serait apparue sous la plume de l’architecte, urbaniste et théoricien, Gustavo Giovannoni (1873 – 1947) : le patrimoine cesse d’être uniquement envisagé au sens strictement architectural et s’incarne désormais dans sa relation à la ville.
Afin de rendre hommage à cette vision plurielle et vivante du patrimoine architectural, Sites & Cités met en lumière cinq de ses adhérents, distingués en 2025 par un avis favorable de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, pour leur Plan de Mise en Valeur et de Sauvegarde ou leur Site Patrimonial Remarquable.
(Re)découvrez les villes d’Aubenas (Ardèche), Auxerre (Yonne), Béziers (Hérault), Mers-les-Bains (Somme) et Sorde-l’Abbaye (Landes), à l’occasion de ces 42e Journées Européennes du Patrimoine.
Alors, « levez les yeux » !
Aubenas : une silhouette singulière entre plaines et montagnes
Située au sud de l’Ardèche, Aubenas constitue un pôle urbain structurant dans une région majoritairement rurale et touristique. Implantée sur un éperon rocheux, la ville domine la rive droite de l’Ardèche.

©CharlèneBoirie

©Alice Repiquet

©drone 26 07_5
Dotée d’un patrimoine particulièrement riche, elle constitue l’une des principales polarités économiques de l’Ardèche. Les différentes époques de son développement urbain y sont encore particulièrement lisibles.
Habité dès l’Antiquité, le site connaît son essor au Moyen Âge, autour de trois châteaux qui polarisent le développement urbain du noyau médiéval. Des vestiges de l’enceinte de la ville subsistent encore aujourd’hui, de même que de belles demeures, d’origine médiévale ou Renaissance, aux escaliers hors ou dans œuvre, aux cours intérieures et galeries. Elles se retrouvent de manière éparse dans le centre ancien, aux côtés des hôtels urbains de l’époque Classique, des immeubles de bourg du XVIIe au XIXe siècle, qui empruntent matériaux et techniques à l’architecture vernaculaire et des immeubles de rapport du XIXe siècle. L’extension urbaine s’est ensuite structurée à partir des domaines agricoles dans la plaine et sur les coteaux, mais les grandes emprises religieuses et les parcs de villas, largement arborés, ont permis de maintenir des espaces de respiration et offrent une véritable ceinture verte autour du centre-ville.
Ainsi, les multiples typologies présentes à Aubenas témoignent de la richesse de son patrimoine architectural, qui résulte d’un long processus de construction, de transformation et de reconstruction.

©ludovicSauzon

©ville aubenas

©ville aubenas
Auxerre : un patrimoine d’une intégrité remarquable, en surplomb de l’Yonne
Située dans une région de plaines fortement marquée les paysages agricoles et viticoles, au nord-ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté, la ville d’Auxerre, relativement dense, bénéficie d’espaces naturels remarquables à proximité immédiate du centre.

©Ville d’Auxerre
Elle connaît son premier essor à l’époque romaine, en tant qu’étape sur la via Agrippa reliant les villes de Lyon et Cologne. A quelques kilomètres de la ville, le site archéologique d’Escolives témoigne de cette histoire avec les vestiges d’une vaste villa et ses thermes qui renferment de nombreux objets du quotidien de l’époque.
Au Moyen Âge, le pouvoir épiscopal façonne profondément la silhouette de la ville. L’abbaye Saint-Germain, édifiée sur le tombeau de l’évêque Germain (418-448), s’impose comme un centre religieux majeur qui contribue au rayonnement intellectuel de la cité. Aux XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, la tour romane Saint-Jean, l’église gothique de l’abbaye et la cathédrale Saint-Étienne viennent compléter durablement le paysage urbain.

©Abbaye Saint-Germain

©Abbaye Saint-Germain
La structure urbaine médiévale du centre ancien est restée intacte et l’architecture du centre ancien : maisons à pans de bois, hôtels particuliers (…) forment un ensemble homogène remarquable. Auxerre poursuit son extension au-delà des remparts et de l’Yonne et se développe dans les faubourgs, où se mélangent les styles architecturaux.
Le quartier du Pont a par exemple été conçu dans un esprit néo-régionaliste, suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, quant au quartier des Boulevards, il se distingue par ses villas remarquables aux vastes jardins, témoins de la ville bourgeoise de la Belle Epoque. C’est ce qui a conduit la collectivité à étendre son Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur à trois quartiers pour préserver les caractéristiques spécifiques de ces secteurs, et valoriser la diversité de son histoire, au-delà du cœur médiéval.

©Ville d’Auxerre

©Ville d’Auxerre
Et Auxerre n’a pas fini de révéler ses secrets … Une partie du site historique est encore enfouie sous le centre-ville et ses abords !
Béziers : un ensemble monumental aux enjeux de relief majeurs
Située sur l’un des derniers contreforts du Massif central entre mer et montagnes, Béziers surplombe la vallée de l’Orb.

©Valérie Rousset

©Valérie Rousset
Fondée par une colonie grecque vers -600 avant notre ère, Béziers serait la plus ancienne ville grecque de France ! Abandonnée puis réinvestie par les gaulois et les romains sur la même trame urbaine, la ville se développe ensuite sur douze petits bourgs à partir du XIe siècle.
Le front rocheux contraint la ville haute à se développer verticalement, le tissu historique y est dense et très minéral. On peut encore admirer deux maisons de la période romane (XIIe – début XIIIe siècles) et de nombreuses demeures gothiques (XIIIe – XIVe siècles), souvent intégrées à des immeubles construits plus tardivement.

©Valérie Rousset

©Valérie Rousset
À la fin du Moyen Age, Béziers connaît un essor significatif dont témoignent de grandes demeures disposant de cours et de tours d’escaliers en vis, avant d’éprouver une période de troubles liés à la Réforme et aux guerres de religion. Ces villas côtoient un réseau de petites maisons particulièrement présentes dans le centre-ville. La ville se dote ensuite d’hôtels aux intérieurs particulièrement ornés aux XVIe et XVIIe siècles. L’élaboration du PSMV a permis de mettre à jour un réseau de caves remarquable et des intérieurs saisissants dans leur état d’origine, tels que des escaliers en bois ou en marbre, des décors peints, des boiseries, des parquets, des oriels, des verrières et des vitraux…

©Valérie Rousset

©Valérie Rousset

©Bernard Wagon
L’urbanisation des quartiers périphériques s’étend au cours des XIXe siècle et XXe siècle et s’appuie sur de grands travaux de percements de voies. Un renouvellement urbain important s’opère également avec la construction de nombreux immeubles commerciaux et de type haussmannien. Des villas avec parc s’installent dans les franges de la ville et plus loin, dans les campagnes environnantes, subsistent encore quelques châteaux pinardiers, imposantes demeures construites dans les styles néo-gothique ou néo-renaissance qui témoignent de la prospérité des négociants de vin et de la riche diversité du patrimoine architectural biterrois.

©Valérie Rousset
Béziers étonne ainsi tant par sa monumentalité que par la diversité architecturale de ses quartiers et par la richesse conservée de nombreux éléments intérieurs.
Mers-les-Bains : perle éclectique de la Belle Epoque
Petit village côtier de la Somme, situé au pied des falaises de la côte d’Albâtre qui dominent la Manche, Mers-les-Bains se transforme au XIXe siècle. L’accès au littoral via l’arrivée du chemin de fer (3h depuis Paris) et la construction des lotissements balnéaires de 1874 à 1896, en font une station remarquée de la Belle Epoque.

Les premiers baigneurs affluent, attirés par la nouvelle activité à la mode : les bains de mer. Issus du milieu de l’industrie, de l’aristocratie, de la riche bourgeoisie parisienne, amiénoise ou encore du Nord, ils viennent s’ancrer dans la ville en construisant leurs maisons de villégiature.
Au début du XXe siècle, la ville de Mers se décompose en trois entités : le bourg situé en hauteur où peu de constructions antérieures au XIXe siècle subsistent, le quartier balnéaire installé en front de plage sur la “Prairie” (anciens espaces agricoles) et les extensions vers les terres.

© Ville de Mers-les-Bains, service communication
Le quartier balnéaire se distingue par son architecture éclectique dont les bains, les casinos et les villas sont emblématiques et par son organisation en lotissements, bâtis d’immeubles aux allures de maisons mitoyennes, divisés en appartements.
La diversité des styles (anglo-normand, picard, mauresque, art déco, art nouveau…) est unifiée par le registre architectural mis en œuvre par les architectes. Ils dessinent le front de mer en multipliant les toitures complexes, les tourelles, les balcons ouvragés, les bow-windows, les loggias, les frises, les façades jumelles, les bandeaux,….
Cela offre une grande unité d’ensemble, enrichie par l’utilisation de matériaux locaux et le recours à une riche ornementation caractéristique de l’époque (céramique, ferronnerie, polychromie, carreaux ciment, vitraux…)

© Ville de Mers-les-Bains, service communication
Au-delà de ce témoignage architectural précieux, Mers-les-bains entretient une relation tout aussi remarquable au grand paysage : Cap Hornu, Baie de Somme, mer du Nord, vallées et paysages agricoles…, qui invite à l’évasion.
Sorde-l’Abbaye : l’équilibre entre patrimoine architectural et patrimoine naturel
Située au sud des Landes, sur les rives du gave d’Oloron, à la frontière avec le Pays basque, Sorde-l’Abbaye se distingue par son environnement naturel vallonné, majoritairement agricole, et la richesse de son patrimoine.

Occupé depuis la préhistoire, le site conserve des traces humaines qui remontent à l’époque magdalénienne, il y a environ 12 000 ans avant J.-C. Des outils en silex ou en os, des objets gravés, ainsi qu’une statuette de cheval agenouillé et un pendentif en forme de tête de cheval témoignent de cette longue histoire.
À l’époque romaine, la présence de deux sites antiques gallo-romains, dont subsistent les fondements des bâtiments et des pavements de mosaïque, confirme l’importance du lieu.
Depuis l’Antiquité, le réseau d’eau a participé à la structuration de Sorde-l’Abbaye. Ses moulins, ses ponts et autres ouvrages hydrauliques jalonnent le cours d’eau et demeurent des témoins d’un savoir-faire ancestral.
Mais c’est au Moyen Âge que Sorde s’impose véritablement, avec la fondation de son abbaye bénédictine au Xe siècle, au rôle spirituel et économique de premier plan. Son architecture romane, ses vestiges archéologiques, son cloître et sa crypte incarnent le cœur patrimonial du village.


Édifiée sur un des chemins de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, la bastide de Sorde bénéficie ainsi d’un attrait touristique important lié à la renommée de son abbaye, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.
La trame urbaine ancienne du bourg organisée autour de l’abbaye a été préservée et des vestiges des fortifications médiévales sont encore visibles aujourd’hui. Les maisons traditionnelles en pierre des XVIIe au XIXe siècle et le bâti rural côtoient les bâtiments monastiques.

©Atelier Lavigne

©Atelier Lavigne

©Atelier Lavigne
L’homogénéité du village est particulièrement saisissante et tient essentiellement à l’unité des volumes bâtis, leurs matériaux et leurs couleurs. Sorde-l’Abbaye séduit pour son authenticité patrimoniale et l’équilibre conservé avec son environnement naturel.
Un grand merci à l’ensemble des collectivités et leur bureau pour leur contribution à cet article.
Sources :
Les BETC de :
- Aubenas – BETC : Agence Raphaneau Fonseca
- Auxerre – BETC : Paris U – Au-delà du fleuve
- Béziers – BETC : GHECO
- Mers-les-Bains – BETC : Gilles MAUREL
- Sorde-l’Abbaye – BETC : Cabinet Lavigne